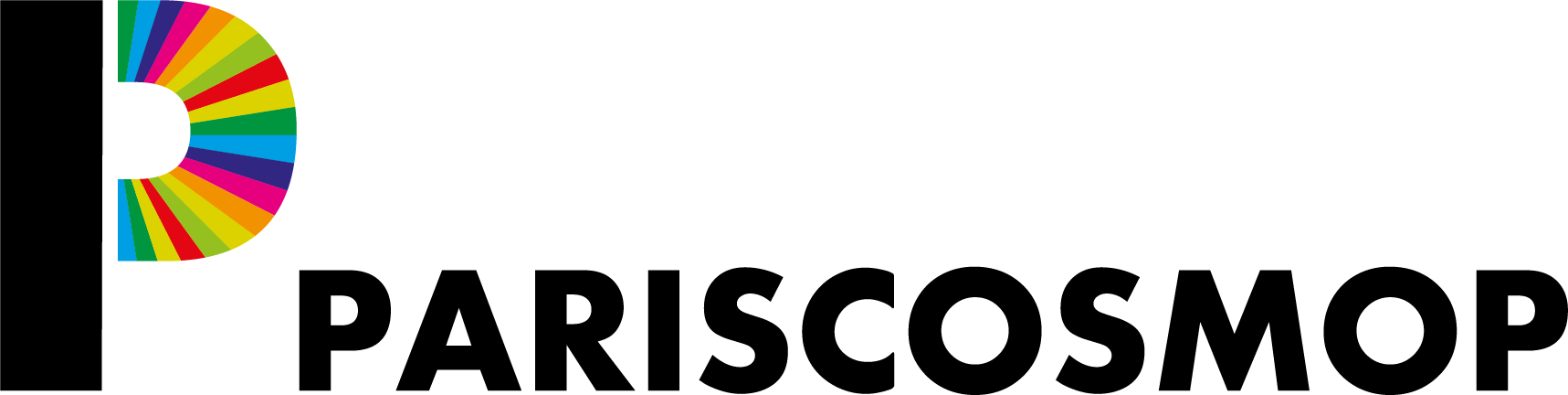Par Wilson OSORIO
Une rencontre hasardeuse. Il n’était pas prévu d’interviewer cette grande dame de la photographie de guerre. L’exposition Femmes photographes de guerre au musée de la Libération était encore en montage: des croquis par terre, bruit des perceuses et des marteaux, des techniciens pressés, des salles en pénombre, quelques photos déjà accrochées, d’autres attendaient leur tour… Christine Spengler, désinvolte et bavarde, était assise au milieu de tout ce désordre méticuleusement agencé. Elle parle l’espagnol avec un accent madrilène charmant, et le français avec un débit lent et mélodieux. Sa voix rauque et profonde rappelle celle de Jeanne Moreau. Ses cheveux courts et noirs coupés avec précision. Son regard pétillant. Son sourire aimable…
«Mes photos de guerre qui sont exposées ici dans ce musée de la Libération sont tristement d’actualité… Ma photo la plus célèbre c’est celle-là», elle signale le cliché pris au Cambodge en 1975 intitulé Bombardement de Phnom Penh et qui est l’image choisie pour l’affiche de l’exposition. «C’était une semaine avant l’arrivée des Khmers Rouges. Il était midi. Le ciel était tout noir car de centaines de rockets sont tombés en peu de temps. Et quand j’y pense maintenant… Nous ne faisons que regarder à la télévision les bombardements sur Kiev».
«Cette guerre me bouleverse. Je ne fais que pleurer. Cette guerre me rappelle toutes mes images […]. Ces enfants que j’ai photographiés dans tous les pays du monde, ce sont aussi quelque part ces enfants d’Ukraine. La guerre n’a pas changée. La tragédie est toujours la même». Enfant, Christine Spengler voulait devenir écrivaine comme son idole Marguerite Duras. Étudiante au Lycée français de Madrid, elle s’apprêtait à poursuivre des études de lettres. Mais un voyage avec son frère Éric a révélé sa vraie vocation.
«Prête-moi un de ces appareils photo!»
«À la mort de notre père en Alsace, mon jeune frère Éric et moi décidons de faire un grand voyage au bout du monde. Et c’est là que par hasard, nous tombons prisonniers au Tchad, dans le Tibesti en guerre. Mon frère n’était pas photographe mais il était l’assistant d’un grand photographe américain. Il avait donc des Nikon. Et moi, quand j’ai vu une scène dans le désert de deux combattants armés qui vont au front en se tenant par la main, j’ai trouvé ce geste d’amitié très surprenant et très beau. J’ai dit à Éric, «prête-moi un de ces appareils photo!, je t’en supplie, car moi aussi je veux en témoigner». C’est comme ça que j’ai pris ma première photo.
«Après 23 jours de prison nous sommes relâchés mais expulsés du Tchad. Sur le chemin de retour, je dis à Éric: «je l’ignorais mais je suis née pour ce métier car quand j’ai un appareil photo entre les mains je n’ai ni froid, ni chaud, ni peur… J’apprendrai mon métier sur le terrain et je deviendrai correspondant de guerre pour témoigner de causes justes»». Elle dit qu’on lui pose souvent la question sur ce qu’elle entend par des causes justes. «Être toujours du côté des opprimés», c’est invariablement sa réponse.
Une image triste et pudique
Elle était justement du côté des opprimés quand elle a pris deux autres de ses photos les plus célèbres. L’une et l’autre sont exposées au musée de la Libération. «Cet enfant Cambodgien», pointe-t-elle le premier cliché, «je le photographie en train de nager dans le Mékong avec tous ces petits camarades. Ils jouent avec des cartouches d’obus vides. Deux heures après, je suis en train de parler avec son père soldat sur une route dans la jungle et il mort à mes pieds. Ces petits camarades le préviennent: «ton père est mort!… ton père est mort!». Lui qui riait insouciant deux heures avant, face au brancard de son père mort il s’agenouille, il s’y agrippe, il s’effondre». C’est cette dernière scène qu’on voit sur la seconde photo.
Christine Spengler explique qu’aussitôt le père de l’enfant tombe mort sur ses pieds, tous ses confrères masculins se précipitent pour photographier le corps, le sang, les pieds coupés… «Moi, je ne prends aucune photo du soldat mort dans le sang. Je me dis non, ce n’est pas ça que je veux montrer parce que tout le monde sait que dans la guerre, les soldats meurent. Je préfère montrer, et c’est ce que j’ai fait, la douleur de cet enfant innocent qui riait avant insouciant et qui est propulsé deux heures après dans l’avant-scène de la guerre. Voici une photo très triste et très pudique».
Sa démarche artistique, Christine Spengler la compare à celle de Robert Capa, le grand photographe États-unien qui ne photographiait pas le sang ni les corps déchiquetés. «Il photographiait plutôt la douleur des victimes. Et je suis pareille. Je me suis toujours intéressée aux victimes et particulièrement aussi aux hommes et aux femmes… Ma spécificité à moi c’est de refuser absolument le sensationnalisme. C’est pour ça que je n’ai jamais voulu photographier en couleur parce que le noir et blanc est beaucoup plus dramatique et parlant».
La condition de femme
Tchad, Irlande du Nord, Vietnam, Cambodge, Liban, Nicaragua, Salvador, Érythrée, Kosovo, Sahara occidental, Irak, Afghanistan… Christine Spengler a couvert les guerres de tous ces pays pour des médias tels que Time, Paris Match, The New York Times, etc. Dans un environnement professionnel dominé largement par les hommes, comment se distinguer en étant une femme? Quels sujets choisir? Depuis quels points de vue les traiter? Elle a fait de sa condition féminine un atout pour se distinguer de ses confrères masculins. Et cela de manière pleinement consciente.
«Je devais profiter le fait d’être femme pour prendre des photos que les hommes ne pouvaient pas faire. En étant une femme et brune de surcroît, j’ai pu, beaucoup plus facilement qu’un homme, dissimuler mon appareil photo sous mon voile ou tchador. Je me suis donc dit: je vais axer mon travail sur ce que les hommes photographient moins en général. Photographier des soldats est très facile. Photographier des femmes soldats voilées c’est une autre chose. C’était plus nouveau, plus original, plus rare de montrer des photos de femmes avec des fusils». Résultat de tout ce raisonnement deux photos poignantes: celle d’une femme du Front Polisario, à Tindouf, avec un fusil en bois et un enfant, et celle d’une vielle dame Palestinienne, au Liban, qui défend sa maison.
«Je suis heureuse que ces deux photos des femmes avec des fusils, plutôt disons des femmes combattantes, soient inclues dans cette exposition du musée de la Libération. On dit maintenant qu’il y a aussi des femmes qui vont prendre des armes à Kiev. Si j’allais en Ukraine, je prendrais toujours les mêmes photos. On a un style. Si j’y étais, je ferais toujours les mêmes. C’est à dire, du noir et blanc, grand-angle, je ne travaille qu’au 28 millimètres… ».
Infos pratiques
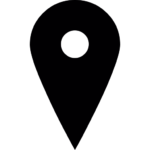 |
Place Denfert Rochereau 75014 Paris |
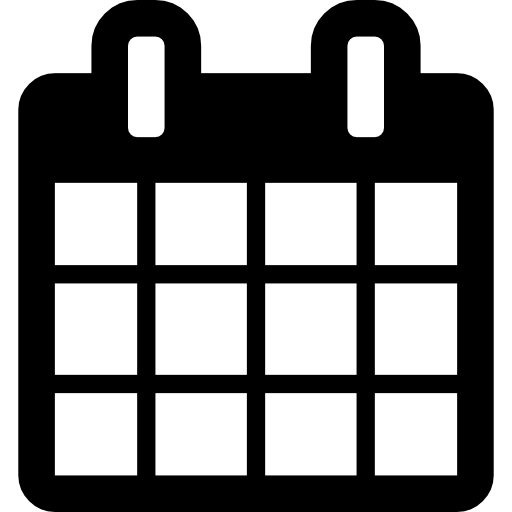 |
Jusqu’au 31 décembre 2022 |
| Site internet |